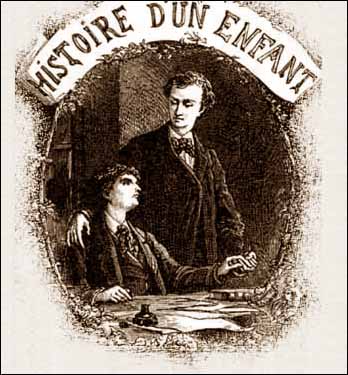|
ALPHONSE DAUDET La véritable histoire du Petit Chose à Sarlande (première partie)
Ce que fut en réalité le séjour d'Alphonse Daudet à Alès par le Chanoine BRUYÈRE
Par une certaine soirée d'avril 1857, les joyeux accents du clairon, lancés à tous les échos dans la rue d'Avéjan par le postillon, annonçaient l'arrivée en Alès de la diligence de Nîmes. Le lourd véhicule s'arrêtait bientôt à son terminus de la Place d'Armes (aujourd'hui Saint-Sébastien) et ses voyageurs s'empressaient de descendre. Parmi eux était un tout jeune homme, un enfant, aurait-on pu croire, bien qu'il fût sur le point d'entrer dans sa dix-huitième année. De petite taille, sans un poil de barbe au menton, une abondante chevelure sortant de sors haut de forme, ses grands yeux de myope; éclairaient un visage aux traits fins et d'une parfaite régularité. Il venait muni d'une lettre de recommandation de l'ancien recteur de Nimes, solliciter au Collège d'Alès, une place de maure d'études, place qu'il occupa pendant un peu moins d'une année.
Environ dix ans plus tard, ce même jeune homme retournait dans le midi, de Paris où il s'était fixé, après avoir quitté Alès. Écrivain qui déjà promettait, il se proposait de chercher, dans le calme d'une grande maison déserte, le château de Saint-Laurent près de Beaucaire. mis à sa disposition par des parents, les dernières scènes d'un drame dont le dénouement ne marchait pas.
Mais, a-t-il dit, l'air du pays, le soleil fouetté de mistral, le voisinage de la ville où il était né, les noms des petits villages où il jouait enfant : Bezouce, Redessan, Jonquières, remuèrent en lui tout un monde de vieux souvenirs et il laissa bientôt son drame pour se mettre à une sorte d'autobiographie
LE PETIT CHOSE, HISTOIRE D'UN ENFANT,
qui, à partir du 27 novembre 1866, parut sous forme de feuilleton, dans :
LE PETIT MONITEUR UNIVERSEL.
Le maître d'études du Collège d'Alès, de Sarlande, comme il l'appelle dans son roman, on l'a reconnu, malgré le nom de Daniel Eyssette dont il s'est affublé, c'est le nîmois Alphonse Daudet, une de nos gloires littéraires méridionales.
Le Petit Chose n'est peut-être pas la meilleure, des oeuvres de Daudet ; c'est une des plus populaires, où se manifestent ses qualités d'émotion vraie, d'exquise sensibilité, et son merveilleux talent descriptif.
La deuxième partie du Petit Chose, celle où sont racontés les premiers mois de la vie de Daudet à Paris, n'est guère, au témoignage même de l'auteur, qu'une oeuvre d'imagination. Mais l'enfance de Daudet à Nimes et à Lyon, et surtout son séjour à Alès comme maître d'études, sont des documents de sa vie vécue et d'un. intérêt palpitant.
Ce séjour à Alès, intéressant par lui-même, l'est surtout pour les habitants de cette ville d'autant plus que Daudet a parlé de « Sarlande » et de son collège avec un manque de sympathie évidente. Aussi éprouvons-nous la curiosité de nous demander s'il mous a dit toute la vérité sur les faits auxquels il a été mêlé pendant le temps où il fut l'hôte de la capitale des Cévennes.
L'auteur de Petit Chose s'est-il toujours montré chroniqueur loyal, ou bien, usant de son privilège de romancier, a-t-il, dans certains cas, inventé, dans d'autres, exagéré, ou même, dénaturé la réalité des choses ?
Tel est le problème que nous essayerons de résoudre.
Grâce à quelques notes, que l'on voudrait moins concises, tirées des papiers même de Daudet ; à ses autres livres et à ceux de son frère, Ernest ; à des informations du journal d'Alès, l’Aigle des Cévennes ; à des renseignements d'un caractère administratif puisés aux archives départementales ; grâce, enfin, à quelques,traditions locales que nous avons pu recueillir, il nous sera possible d'illustrer, parfois de rectifier certaine pages du roman où Daudet nous a longuement parlé des quelques mois qu'il a passés à Alès.
Sans nous vanter d'avoir réussi â faire la lumière complète, sur tous les épisodes de ces mois, nous ne croyons pas être trop téméraire en disant que nous avons réussi à en éclaircir le plus grand nombre.
Alphonse Daudet était né à Nîmes le 3 mai 1840. Il y demeura jusqu'au moment où les mauvaises affaires de son père qui possédait une fabrique de foulards, au chemin d'Avignon, là où est maintenant le monastère des Carmélites, obligèrent celui-ci et sa famille â s'installer à Lyon.
On mit tout d'abord le jeune Alphonse dans une manécanterie, mais bientôt l'ancien recteur de l'Académie de Nimes. M. Nicot, avec qui la famille était liée d'amitié, lui fit avoir une bourse d'externat au collège de Lyon. Il y entra en 6me et y termina sa rhétorique en 1856. Ses succès scolaires furent médiocres. Les palmarès ne lui attribuent que des accessits :
« Nous .étions loin de le supposer comme fort, a écrit de lui un de ses condisciples. Il apparaissait plutôt aux premiers de la classe comme insignifiant, et dans les compositions personne ne le redoutait ».
Ce n'était certes pas manque d'intelligence. Si Daudet « le Petit Chose » ainsi que son professeur de 6me l'avait surnommé, fut un piètre élève, ce fut par suite du manque de surveillance dont ses parents furent. coupables à son égard. Les affaires de Vincent Daudet, son père, ne cessaient de péricliter et Madame Daudet, excellente femme, mais timide, abattue par le malheur et trop grande liseuse de romans, comme l'étaient alors beaucoup de dames de la Société, laissait le plus souvent son fils agir comme il l'entendait.
Le Petit .Chose était donc pratiquement libre. Après avoir, a-t-il dit lui-même, éprouvé des crises religieuses faites de doutes et puis de remords qui le conduisaient en des coins d'églises désertes où furtivement il se glissait honteux et tremblant d'être vu, il s'emporta brusquement, vers sa treizième année, dans un besoin éperdu de vivre, de s'arracher aux tristesses racornies, .aux larmes qui étouffaient l'intérieur de ses parents, de plus 'en plus assombris par la ruine. L'enfant délicat et timide se transforma alors et devint hardi, violent, prêt â toutes les folies. Il manquait la classe, passait es journées sur l'eau, ramait sous la pluie, la pipe aux dents, un flacon d'absinthe ou d'eau-de-vie dans la poche, manquant avec sa myopie d'être mille fois tué. En compagnie de quelques camarades, il avait secrètement loué une petite chambre, et, afin d'essayer l'apprentissage du quartier latin, il fumait et buvait à tire que veux-tu.
Il n'en était pas moins un lecteur insatiable de livres, bons et mauvais. Il écrivit même des vers dont certains sont délicieux et son talent naissant le mit en relations avec plusieurs homme. de lettres lyonnais. Cependant l'époque de son baccalauréat approchait.
C'est en août 1857 que Daudet aurait du se présenter à l’examen.
Rappelons qu’alors le baccalauréat ne comprenait qu’une partie et se passait à la fin de la classe de philosophie. Son année de philosophie était sur le point de se terminer, lorsque, au mois de mars ou avril, un parent de Nîmes, sans doute son oncle Reynaud, conseilla au père du jeune Alphonse de solliciter pour celui-ci son admission dans un collège du Midi comme maître d'études. L'enfant pourrait préparer là ses examens, vivre quelque temps sans rien coûter à sa famille et même réaliser dés économies. Cette offre sortait trop bien d’embarras la famille Daudet pour qu’elle ne fût pas acceptée avec empressement.
Voilà donc le futur surveillant quittant Lyon, au commencement des vacances de Pâques 1857, par le bateau à vapeur qui alors, assurait sur le Rhône la communication entre Lyon et Arles, et qui devait cesser son service, quelques mois après, en janvier 1858, la concurrence n'étant plus possible avec le chemin de fer qui, en trois fois moins de temps, accomplissait le même trajet.
S'il faut en croire le roman du « Petit Chose », Daudet serait allé directement à Alès, après avoir vu dans sa ville natale l'ancien recteur de l'Académie de Nîmes dont il ne dit pas le nom, mais qui était Monsieur Nicot. En réalité, c’est ce que nous apprend Monsieur Ernest Daudet dans son livre « Mon frère et moi », il passa quelques jours dans sa famille à Nîmes où des cœurs fraternels l’accueillirent tendrement, puis, aux environs du Vigan « à Bréau, croyons-nous savoir » chez des cousines.
Daudet vit-il Monsieur Nicot avant ou après ?
Peu importe. Dans son livre, il nous a raconté son entrevue avec l'ancien recteur. Lorsque celui-ci vit entrer le « Petit Chose » dans .son cabinet, il ne put retenir un geste de surprise :
« Ah ! mon Dieu, dit-il, comme il est petit ! »
L'exclamation du recteur porta un coup terrible au jeune homme. Ils ne vont pas vouloir de moi, pensa-t-il ; et tout son corps se mit à trembler. heureusement le recteur reprit :
« Approche ici, mon garçon. Nous allons donc faire de toi un maître d'études. A ton âge, avec cette taille et cette figure-là le métier te sera plus dur qu'à un autre. Mais enfin, puisqu'il faut que tu gagnes ta vie, mon cher enfant, nous arrangerons cela pour le mieux. En commençant, on ne te mettra pas dans une grande baraque. Je vais t'envoyer dans un collège communal, à quelques lieux d'ici, à Sarlande, en pleine montagne. Là tu feras ton apprentissage d'homme. »l
Tout en parlant, Monsieur le recteur rédigea une lettre au principal du Collège de Sarlande pour lui présenter son protégé.
Pourquoi le collège d'Alès avait-il été choisi ?
Non seulement parce que c'était une petite maison qui comptait alors environ 130 élèves, et, nous apprend une lettre de son principal à l'Inspecteur d'Académie, manquait à ce moment de Maître d'études, mais aussi à cause des souvenirs de famille qui s'attachaient à l'établissement.
Un oncle de la mère de Daudet, l'abbé François Reynaud, qui avait traversé la Révolution, exilé en Angleterre, en avait été le principal de 1813 à 1835, année où il était mort victime de .son dévouement au cour d'une épidémie de choléra ; si bien qu'au Collège d'Alès étaient attachés les plus doux souvenirs de jeunesse de Madame Daudet. Elle le revoyait toujours tel qu'elle J'avait vu jadis quand l'intelligente et paternelle direction de l'oncle l'abbé le rendait florissant et en faisait un séjour aimable.
Le principal du Collège d'Alès était, en 1857, Monsieur Ferdinand Roux, un alésien qui avait fait ses études comme boursier au collège royal de Nîmes, sous la Restauration. Il avait été nommé le 10 octobre 1845 et resta en fonctions jusqu'en août 1858. A cette date, à la suite de difficultés qu'il eut avec la municipalité de la ville, et peut-être aussi parce que le nombre des élèves avait baissé dans d'assez grandes proportions, de 181 en 1854, il était, en 1858, tombé à 116, il fut changé à Castres, puis à Cluny. Il prit sa retraite à Alès dans une maison aujourd'hui démolie de la rue de la République où il est mort à l'âge de 85 ans en 1898. C'était un homme digne, persuadé de l’importance de ses fonctions, à son devoir, cachant sous des dehors sévères un coeur très bon.
Lorsque le jeune Daudet se présenta devant lui, il fut sur le point de ne pas être admis. Son air de jeunesse et sa petite taille firent leur ait principal. « J'avais. demandé un maître, voilà qu'on m'envoie un enfant » ne put il s'empêcher de s'écrier. S'il accepta le Petit Chose ce ne fut que grâce à la lettre de recommandation du recteur et à l’honorabilité de la famille Daudet.
Les maîtres d’études (leurs fonctions sont remplies de nos jours par les maîtres d’internat et les répétiteurs) pouvaient à cette époque être admis, même sans titres universitaires, par les principaux et recevaient d’eux leur traitement qui n'avait rien de fixe et de précis. Le traitement de Daudet qui était logé et nourri dans la maison fut de 600 francs par an. C'est du moins le chiffre que Monsieur Roux déclarait. en 1858, dans une lettre à l'Inspecteur d'Académie de Nimes donner à ses maîtres d'études.
L'édifice qui allait abriter Daudet n’était pas celui du Lycée, actuel, le lycée Jean-Baptiste Dumas, qui ne remonte qu'à 1889 et a été édifié dans un autre quartier de la ville. l'ancien Collège d’Alès était situé dans la rue Pasteur ; il sert aujourd'hui de caserne de la garde mobile.
Les origines de ce collège remontaient au début du 18e siècle ; son fondateur avait été Mgr d’Avéjan, celui des sept évêques ayant occupé le siège d’Alès qui a laissé le plus grand souvenir. Jusqu'alors à la fois collège et séminaire, il subit, en 1780, sous le dernier évêque d'Alès, Mgr de Bausset, le futur cardinal de la Restauration et l'historiographe de Bossuet et de, Fènelon, une transformation complète. Il devint Ecole royale de la Marine, et, s'il ne compta pas « huit cents élèves et tous de la plus haute noblesse », ainsi que le déclarait au « Petit Chose » le concierge de la maison, il eut une certaine célébrité, éphémère d'ailleurs, puisque la Révolution de 1789 devait fermer ses portes. Après la tourmente, l'Ecole de la Marine redevenait Collège, mais cette fois établissement de l'Université Impériale.
Ses locaux étaient restés les mêmes. Imaginez un T renversé dont la bande supérieure est en façade de la rue et celle perpendiculaire sépare les cours de récréation de l'établissement. Au rez-de-chaussée du corps principal sur la rue était une porte cochère surmontée des armes d'Alès, (de gueules à un demi-vol à dextre d'argent) ; cette porte a été remplacée, en 1940, par un rideau de fer pour permettre le passage des cars de la police.
Un double enseignement se donnait dans l'établissement un enseignement secondaire classique et un enseignement professionnel correspondant à celui de nos écoles primaires supérieures.
C'est le lendemain de son entrevue avec le principal que Daudet commença ses occupations au Collège. D'après son roman, il aurait passé la nuit dans un bon petit hôtel voisin, pas trop cher, où il se serait endormi, assoupi par la lecture du règlement du Collège que lui aurait remis le surveillant général. Dans un autre de ses livres, au contraire, il a prétendu que, dépourvu d'argent, il aurait rodé toute la nuit clans la ville et qu'au matin il avait avalé quelques verres de rhum. Ailleurs encore il nous apprend que le matin du jour où il entra en fonctions, il acheta un monocle pour se donner un air plus âgé et ajouter à sa dignité.
Une des premières personnes que vit le nouveau surveillant dans les couloirs du Collège, le soir même où il y• pénétra, fut une « vieille, ridée. ratatinée, pliée en deux, avec d'énormes lunettes lui cachant la moitié du visage » et que, dans sa pensée, il baptisa tout de suite « l'horrible fée aux lunettes ». On lui dit plus tard qu’elle était une tante du principal et remplissait les fonctions d'économe. Elle était en réalité sa mère.
Sur Madame Roux, comme sur d'autres personnages du « Petit Chose », nous avons été renseignés par un vieil alésien, mort en 1940, M. Caumel, avoué honoraire, entré au Collège, en 1862, élève interne de 8me, qui avait conservé avec une grande lucidité le souvenir de son enfance, raison pour laquelle on l'appelait volontiers « l’ancêtre ». « Les habitudes d'ordre et d'économie de Madame Roux, nous a-t-il dit, n’étaient pas toujours appréciées à leur valeur par les élèves, prompts à se plaindre du régime de la maison. Mais la fée aux lunettes m'avait pas trop l'air de s'en émouvoir ».
« Protestante austère, elle n'avait pas suivi son époux qui s’était converti au catholicisme, et jamais elle ne voulut, malgré les prières de son fils, abjurer sa religion. Pour expliquer son attachement, à ses convictions huguenotes, on la disait descendre, en ligne collatérale, de Jean Cavalier.... le chef camisard ».
A l'exception du professeur de philosophie, dont nous parlerons plus longuement, du maître d'escrime et du surveillant général, Daudet eut peu de rapports avec le corps enseignant du Collège d'Alès qui, d'ailleurs, dès le .début, prêta médiocre attention à sa personne. Le jour où il commença son service, il attendait l'entrée des externes sous le porche, prés de la loge du concierge, ce concierge à qui il a donné le nom de Cassagne, qui s'appelait Lavergne en réalité, et dont il n'a pas exagéré le caractère obséquieux. Je me promenais de long en large, a-t-il écrit, saluant jusqu'à terre Messieurs les Professeurs qui accouraient essoufflés.
Un seul de ces messieurs me rendit mon salut, c'était un prêtre, le professeur de philosophie « un original » me dit le surveillant général. Je l’aimai tout de suite cet original là.
Le jeune Daudet ne tarda pas sans doute à être frappé par la situation particulière du professeur de première. Il n'en a pas parlé dans son roman ; mais clans les notes qui constituent le tout premier projet du « Petit Chose », il a écrit ces mots comme susceptibles d’un développement ultérieur, auquel il n'a pas donné suite, « le professeur aveugle ».
Ce professeur, à Alès depuis 1831, était, Monsieur Coirard, ancien régent de rhétorique; au Collège de Montélimar. Il ne possédait, en fait de titres universitaires, que celui de simple Officier d'Académie, mais, malgré la cécité à peu prés complète dont il était affligé, il était. d'après son principal de Montélimar un excellent professeur. Un état du corps professoral d'Alès déclare que, si son enseignement était un peu emphatique, il n'en avait pas moins une grande action sur les élèves. Pas sur tous, dirons-nous, car il arrivait parfois que certains, profitant de son infirmité, lisaient leurs leçons au lieu de les réciter et se permettaient des gestes et des plaisanteries pour exciter l'hilarité de la classe. Une lettre de la Veuve Glachaud d’AIès, dont le fils avait été renvoyé pour ce motif, nous a appris cette particularité dont ne seront surpris que ceux qui, ne s'étant pas occupé d'enfants, ne peuvent soupçonner ce dont ils sont capables en bien et en mal.
Le surveillant général, lui, savait se faire craindre, et Daudet nous en a longuement parlé. On ne se sourient de ses clefs dont le fic fic exprimait si bien sa pensée, de son cahier de règlement, véritable traité dont il était l'auteur, divisé méthodiquement en trois parties et où tous les cas étaient prévus, depuis le carreau brisé jusqu'aux deux mains qui se lèvent en même temps en étude ; de son talent de poète enfin, écrivant en l'honneur du règlement une idylle toute virgilienne, dans laquelle l'élève Ménalque et l'élève Dorilas se répondent en strophes alternées, l'un d'un collège où fleurit le règlement, l'autre d'une maison d'où le règlement est exilé ?
La lecture de cette idylle aurait eu lieu, le jour de la Saint Théophile, le 13 octobre, au cours d'un repas champêtre organisé à la Prairie pour la fête de la maison. Le « Petit Chose », lui aussi aurait lu en cette circonstance quelques vers « un compliment, a t’il dit lui-même, assez bien tourné, plein de rimes aimables à l'adresse du principal et de tous les professeurs ». On l'aurait applaudi longuement, alors que la lecture du poème du surveillait général se serait terminée par un silence de mort.
Les notes du premier projet du roman, silencieuses sur cet épisode, nous apprennent qu'à l'occasion de la fête de la fille du principal, des vers furent également débités. Elles ne nous disent pas par qui.
Daudet a donné au surveillant général le nom de Viot. Il s'appelait en réalité Monsieur Plot. Du collège du Vigan, il a été nommé, en 1854, suppléant pour la classe de 5me, au Collège d'Alès, et, cette année là, avait prononcé le discours de distribution des prix. En 1856 et 1857, il avait fait fonction de surveillant général, fonctions dont, au témoignage de Monsieur Roux, dans une lettre à l'inspecteur d'Académie, il s'était acquitté avec dévouement.
Daudet a reproché à Monsieur Plot d'être méticuleux froid, rancunier, ne pensant qu'à, une stricte observation du règlement, et il n'a manqué aucune occasion de le tourner en ridicule. Nous ne savons si Monsieur Piot manquait de coeur, mais aurait il bien rempli ses fonctions, s'il n'avait pas fait tous ses efforts pour faire régner la discipline ?
II est de fait qu'il était sévère, quelques années après son départ d’Alès, il le quitta en octobre 1858, nommé sous principal au Collège de Castres, on avait gardé son souvenir, qualifié d'effroyable par M. Caumel, qui avait entendu parler de lui. Daudet, avec sa nature primesautière et impulsive ennemie de la contrainte, ne pouvait comprendre Monsieur Piot. Cette incompréhension ne l'a t'elle pas disposé à être injuste à son égard.
Qui sait encore si la qualité de poète du surveillant général n'a pas, elle aussi, contribué à accentuer l'attitude de Daudet à son égard ?
Monsieur Piot, nous disent les notes, était poète. Cette phrase, anodine d'apparence, ne cache t'elle pas une jalousie d'auteur ?
Si Daudet n'a pas été satisfait de l’attitude de Monsieur Piot à son égard, ce digne universitaire avait des raisons autrement fondées de ne pas l'être, à son tour, pour la façon dont son subordonné s'acquittait des fonctions qui lui avaient été confiées.
Tout d'abord Alphonse Daudet eut e la charge de la division des petits, composée de 35 élèves. Ils n'étaient pas méchants, nous a t'il dit ; aussi je ne les punissais jamais, est ce qu'on punit des oiseaux ? Quand ils pépiaient trop haut, je n'avais qu*à crier Silence ! Aussitôt ma volière se taisait au moins pour cinq minutes. Il leur racontait quelquefois des histoires, mais cette méthode ne fut pas du goût de Monsieur Piot, et le « Petit Chose » comprit qu'il ne fallait plus en raconter. Malgré tout, ses élèves ne lui causèrent pas d'ennuis majeurs. Le plus grand qu'il ait éprouvé consistait à traverser les rues de la ville pour se rendre à la Prairie le jeudi et le dimanche, avec une colonne qu'il était impossible de faire marcher en rang.
Et, parmi ces élèves, était le jeune Bamban, horrible avorton, profondément bancal, sale et indiscipliné, le fils d'un maréchal-ferrant qui, entendant vanter partout les bienfaits de l'éducation, se saignait les quatre membres pour envoyer son enfant demi-pensionnaire au collège. Hélas ! ce dont Bamban était seulement capable, c'était de faire des bâtons. Bamban finit par devenir l'ami du « Petit Chose », si bien que lorsqu'il avait terminé une page de bâtons. Il s'empressait de gravir à quatre pattes la chaire du surveillant et posait soit chef-d’oeuvre devant lui sans parler. Il parait que Bamban qui jamais ne put mordre aux études s'évada plus tard du Collège en passant par un égout, et, après avoir essayé de plusieurs métiers, finit par celui de tailleur.
C'est pendant la période où Daudet fut chargé de l’étude des petits qu'il put, si nous en croyons, travailler pendant les heures de classe, dans sa petite chambre du deuxième étage, se bourrant de grec et de latin à se faire sauter la cervelle. Il voulait, en faisant beaucoup de thèmes grecs, passer licencié, rappelons-nous qu'il n’était même pas bachelier, être nommé professeur et reconstruire au plus vite un beau foyer tout neuf pour la famille Eyssette.
Mais bientôt, sur la fin de l'année scolaire, il lui fallut quitter l'étude des petits pour celle des moyens. Ah ! ces moyens, une cinquantaine de méchants drôles, montagnards joufflus de douze à quatorze ans, fils de métayers enrichis que leurs parents envoyaient au collège pour en faire de petits bourgeois, comme Daudet les a décrits avec indignation et mépris !
Il ne s'est même pas fait faute de donner noms de quelques uns, à peine modifiés, ceux de Crouzat, qui devait devenir le gendre de M. Bourgogne, pharmacien, de Veillon qui prit la suite de l'usine de construction mécaniques fondée par son père, de Soleirol, de Laupie, de Bouzanquet. Grossiers, insolents, orgueilleux, parlant entre eux un rude palois cévenol auquel je n'entendais rien, ils me haïrent tout de suite, sans me connaître. J'étais pour eux l'ennemi, le pion, et, du jour où je m'assis dans ma chaire, ce fut la guerre entre nous, une guerre acharnée, sans trêve, de tous les instants. Des farces, ils allaient lui en jouer, sans pitié aucune, jusqu'à le faire pleurer de rage et de chagrin le soir venu, blotti dans sa couchette, mordant sa couverture pour étouffer ses sanglots.
Ernest Daudet nous en a fait connaître une, un jour, a-t-il écrit dans « Mon frère et moi », ne s'avisèrent-ils pas de traîner au travers de l'escalier une vieille malle toute hérissée de clous. Alphonse n'y voyait pas et se laissa choir, au risque de se tuer.
Tout d'abord, le malheureux maître d'études avait essayé de la douceur, une douceur trop grande, puis, tombant dans l'excès contraire, il se montra sévère et, surtout lorsqu'il avait bu car Daudet buvait, nous le verrons plus loin, pour la moindre incartade, il foudroyait toute l'étude de pensums et de retenues. Ce système ne lui réussit pas. « Mes punition à force d'être prodiguées, se déprécièrent et tombèrent aussi bas que les assignats de l'an IV. Un jour, je me senti débordé. Mon étude était en pleine révolte et je n'avais plus de munitions pour faire tête à l'émeute. Je me vois encore dans ma chaire, me débattant comme un beau diable, au milieu des cris. Et les encriers pleuvaient, et les papiers mâchés s'abattaient sur mon pupitre, et tous ces petits monstres, sous prétexte de réclamations se pendaient par grappes à ma chaire avec des hurlements de macaques ».
Daudet a t-il exagéré ? Peut-être quelque peu, mais dans le fond nous pouvons l'en croire. Serait-ce donc que les petits Alésiens ou Cévenols sont plus méchants que les enfants d'autres pays ? Pas nécessairement. Une expérience déjà longue nous permet d'affirmer qu'ils sont relativement dociles, quoique un peu frustes, peut être, et n'avant pas le savoir vivre et les délicatesses charmantes, par exemple, des petits Parisiens. Monsieur Ernest Daudet a prétendu que l'attitude des élèves du Collège d'Alès leur fut inspirée par une sorts de jalousie envers leur surveillant, pour eux trop distingué, trop fin, trop fier, beau comme un jeune dieu et dont les regards disaient l'intelligence. Point n'est besoin d'avoir recours à cette explication.
les encriers pleuvaient, et les papiers mâchés s'abattaient sur mon pupitre
La vraie raison est que le « Petit Chose » d'ailleurs beaucoup trop jeune, n'avait rien de ce qu'il faut pour être surveillant. Il en est résulté que ses élèves, ne se sentant pas tenus par une main forte et, d'autre part, insensibles, comme le sont la plupart des enfants, à la pitié, ont mené la vie dure à celui que, tout naturellement, ils considéraient comme leur ennemi.
Le surveillant idéal doit avoir bon oeil et bonne oreille il doit être froid, positif et calme, il ne lui convient pas de discuter avec les élèves, mais il doit s'imposer à eux par une fermeté toujours égale et un sens aussi parfait que possible de la justice. Il faut que chaque élève ait le sentiment qu'il a en face de lui quelqu'un de plus fort, qui le connaît et qui, sa décision prise après réflexion, ne cédera pas. Comment dans ces conditions Daudet, que sa myopie exposait à des méprises, qui était un sentimental, un velléitaire et un impulsif, aurait-il pu prétendre I'réussir dans une tâche pour laquelle il n'était nullement fait ?
Nous nous indignons que ses élèves l’aient fait souffrir, et nous compatissons à ses souffrances, mais peut-on changer la nature des enfants inaccessibles au bon sens et à la pitié, surtout à l'âge ingrat de dix à quinze ans ?
Le père de l'enfant battu était, d'après le roman, un officier en retraite : sa rapière, une grande diablesse de colichemarde, n'avait-elle pas fait tant de victimes, lorsqu'il était aux gardes du corps ? Il vint faire une scène au Collège. Le jeune pion fut vertement blâmé ; et, s'il ne fut pas renvoyé, il ne le dut qu'à la protection du recteur.
Le baron Charles d'Hombres ne fut jamais garde du corps. Pourquoi Daudet l'a t il ainsi qualifié, et avec bonheur, car cette profession nous a valu la superbe expression : grande diablesse de colichemarde ? Nous ne pensons pas qu'en cette circonstance il se soit inspiré de sa seule imagination. En, ces années 1857-1858, vivait encore à Alès, le comte Henri de Ramel, ancien militant du parti légitimiste après 1830, qui, effectivement, avait été garde du corps vers 1815. Il est vraisemblable que Daudet aura entendu parler de lui et de son caractère rigide et emporté, et, plus tard, lorsqu'il écrivit son livre, ce souvenir lui revint à la mémoire.
Plus comique et invraisemblable est la suite de l'histoire. Le « Petit Chose » nargué par le père de l'enfant battu, lorsque pour conduire les élèves en promenade, il les fait défiler devant le Café de l'évêché, consulte le maître d'armes, lui demande des leçons d'escrime et a la prétention de confier à son épée le soin de venger son honneur. Disons en passant que, si le café de l'évêché a bien existé à Alès, installé au rez-de-chaussée de l'évêché construit par Mgr. d'Avéjan, il n'est pas sur le chemin qui, du collège conduit à la prairie, lieu habituel de promenade des élèves, à moins, bien entendu, que ce chemin, ne soit celui des écoliers. Ici, encore, Daudet a sacrifié au pittoresque.
Le maître d'armes tient une grande place dans le roman du « Petit Chose ». Daudet l'appelle Roger. Quel était son vrai nom ? Si, en 1857, c'était le même personnage qu'en 1854, il se serait appelé Godet, d'après un palmarès de cette année que nous avons eu entre les mains. Les autres palmarès ont disparu et le plus ancien qui ait été conservé dans les archives du Lycée est celui de 1866. Roger, un ancien sous-officier, n'était pas un grand personnage, puisqu'il cumulait avec son emploi de maître d'armes et de professeur de gymnastique, celui de brosseur du principal. Daudet nous l'a décrit : bellâtre, beau parleur et fourbe, aimant à fréquenter la loge du concierge et surtout le café Barbette où il avait fini par entraîner le « Petit Chose».
Le café Barbette lui aussi n'est pas une création de Daudet, Il se trouvait au n° 4 de la Place Saint-Sébastien. Son enseigne portait : Café Anténor, et « Barbette » était le nom de son tenancier alors. Il s'appela plus tard « café de la Cascade », vers 1830, il a disparu. C'était le café des sous-officiers de la garnison, le 3me bataillon du 65me Régiment d'Infanterie, plein de cris, de fumée, de pantalons garance, ce qui frappait en y .entrant, c'était la quantité de shakos et de ceinturons pendus aux patères.
Disons à propos de la garnison d'Alès, casernée dans le local de l'actuel Collège de jeunes filles, rue Saint Vincent, qu’il est une indication des notes sur laquelle nous n'avons pu faire la pleine lumière : « la musique, le membre de l'Institut, le major juge de la musique ». Le membre de l'Institut était l'alésien Jean Baptiste Dumas, venu le 19 mai 1857, au collège où il avait été élevé. La presse locale annonçant sa visite ajoutait que l'illustre chimiste s'était proposé d'étudier à Alès la maladie des vers à soie. Il fut sans doute fêté par un concert de la musique de la garnison. Mais en quoi consista l'incident signalé par ces mots : le major juge de la musique, nous l'ignorons.
Le « Petit Chose » était allé au café Barbette, une première fois, lors de son arrivée en Alès, participer à un punch d'adieu offert par celui qu'il remplaçait au Collège. Pour se donner de l'importance, il avait raconté effrontément qu'il appartenait à une famille très riche et, qu'à la suite de quelques folies de jeune homme, on l'avait chassé de la maison paternelle ; il s'était fait maître d'étude pour vivre, mais il ne pensait pas rester longtemps au Collège.
Depuis, Daudet, du moins, il le prétend, n'avait plus mis les pieds au café et avait passé son temps libre à travailler dans sa petite chambre.
Après ses déboires avec la division des grands, le goût du travail lui avait passé, et en dehors des heures de classe, il courait s'enfermer chez Barbette d'où il ne sortait qu'au dernier moment. N'agit-il de la sorte qu'après les grandes vacances et l'affaire Boucoyran survenue alors, et, parce qu'il trouvait sa mansarde trop froide ? C'est la chronologie du roman, les notes placent avant les vacances la fréquentation du café et nous donnent des détails que le roman a cachés. Si ce dernier nous raconte qu'en la compagnie de sous-officiers, il apprit à édulcorer une absinthe, il la buvait pure à Lyon, et à marquer les points quand ces messieurs jouaient au billard, nous savons de par ailleurs, par le livre « Les Gueux de Province », qu'il se grisait en buvant des absinthes qui lui cassaient la poitrine, qu'il jouait à un sempiternel domino, et se rendait presque toujours à son étude, la bouche pâteuse et l'oeil absinthé. Les notes du tout premier projet du « Petit Chose », portent, elles aussi, les indications suivantes « Mauvaise vie ; je me grise ; je marque les points au billard ».
Au café, Daudet fréquentait également des comédiens, ceux sans doute de la troupe dramatique recrutée à Alès par un Monsieur Julien et qui, à partir de juillet 1857 jusqu'à la .fin de l'année, joua au théâtre de la ville des opéras comiques Gil Pérez, le Domino Noir, les Mémoires du diable, et autres.
Le café Barbette n'était pas le seul lieu où passait son temps libre le jeune Daudet ; il se rendait également à la Prairie et était lui hôte assidu des guinguettes plus ou moins louches que l'on y trouvait. II nous a donné, le nom de l'une d'entre elles, qui a réellement existé et dont nous connaissons l'emplacement la guinguette Espéron. Elle n'a pas disparu, c'est une petite construction, en forme de cube, entourée de terrasses, de tonnelles et de grands châtaigniers. Daudet aimait la fréquenter ; et même, dit-on, faisait danser plus d'une fois sur ses genoux, le bébé de la patronne.
La Prairie, située à un kilomètre de la ville, sur l'autre rive du Gardon n'est plus guère maintenant ce qu'elle était autrefois. L'extension de la ville, le nombre croissant des jardins potagers et des vergers de pêchers l'ont en grande partie dénaturée. C'était il y a quelques 80 ans, un lieu délicieux avec ses grands et nombreux châtaigniers, son gazon entretenu bien vert, non par une source pive, dont il est question dans le roman, cette source n'a existé que dans l'imagination de Daudet mais par l'humidité du sous-sol. La plupart des châtaigniers ont disparu et à leur place s'élèvent de nombreuses villas, un dépôt de balayures dépare les lieux, et un terrain de sport, enclos de barrières en ciment armé, le moins esthétique et le plus froid des matériaux de construction, auquel malheureusement nous sommes condamnés, étale prosaïquement son caractère utilitaire. Cependant quelques petits coins de l'ancienne Prairie subsistent qui permettent de se faire une idée de ce qu'elle fut jadis.
Mais pourquoi Alphonse Daudet fréquentait-il ce milieu de soldats et de comédiens « milieu malsain, pervers, bohème inintelligente et sotte, où, à tout instant ,comme a écrit son frère, quelque piège était tendu à sa naïveté ? » Toujours, d'après Ernest Daudet, c'est parce que. entouré au collège de « cagots et de cuistres qui le méprisaient et lui auraient fait subir les basses humiliations du pauvre, victime encore de la politique d'espionnage et de délation de Monsieur Plot » il aurait cherché, comme poussé par le désespoir, à s'étourdir.
Le vrai coupable ne serait-il pas la nature impétueuse du jeune surveillant, son absence de contrôle sur lui-même, développée par son éducation trop libre et sans discipline. La vie dissipée d'Alès ne faisait que continuer celle qu'il avait déjà vécue à Lyon. Car Daudet n'a pas été totalement abandonné au Collège d'Alès, ainsi qu'il l'a prétendu ; son principal s'était intéressé à lui l'avait protégé et réconforté par sa bienveillance, et, plus d'une fois, nous a appris un vieil Alésien, Monsieur Blavet, l'avait fait asseoir à sa table. Parlerons-nous d'un autre service qu'il lui rendit ?
Un jour qu'une procession devait se dérouler dans les cours du Collège, Monsieur Roux prêta à son subordonné, dont le vestiaire laissait à désirer un vaste pantalon à carreaux qui, parait-il, lui donnait l'air d'un de ces petits singes que l'on voit, affublés d'oripeaux, danser dans les cirques. Ce service, il faut bien le dire, était plutôt de nature à humilier le jeune surveillant qu'à faire naître des sentiments de reconnaissance dans son âme. Que n’a-t-il aussi cherché à se lier avec l'aumônier, l'abbé Pélissier, ancien élève du Collège et curé de Saint Paul de Beaucaire, en fonction depuis 1854, qui devait plus tard être transféré à la cathédrale d'Uzès et mourut chanoine titulaire à Nîmes ?
C'était un prêtre lettré qui plaisait aux élèves par les saillies de son humeur souvent très gaie. et aux maîtres par la finesse et la distinction de son esprit.
Il n'a pas fait la moindre, allusion à lui, comme s'il n'avait pas existé. Il est vrai que l'aumônier ne logeait pas dans le Collège, bien qu'un appartement lui fût réservé. Il habitait en ville et avait au Plan d'Alès, un jardin où il se plaisait à cultiver des fleurs et des fruits primés aux concours agricoles. Mais pourquoi chercher si loin ? Daudet n'a-t-il pas eu la sympathie, un peu rude et cavalière, mais si profonde de l'abbé Germane ? Il l'a reconnu et dans le « Petit Chose » et dans « Trente ans de Paris » « Pas d'autre, sympathie dans cette geôle douloureuse que celle du prêtre que j'ai appelé l'abbé Germane ».
Ce nom est, ,en effet, un nom d'emprunt, et l'abbé Germane était en réalité l'abbé Cassan. Figure curieuse que la sienne, bien capable d'impressionner un imaginatif, comme le « Petit Chose » et dont la réputation avait franchi le seuil du Collège.
L'abbé Casimir Louis Auguste Cassan qui venait de Narbonne où il était chargé de la classe de philosophie, avait été nommé, le 7 octobre 1850, professeur de logique dénomination officielle, depuis cette année même, 1850 de la classe de philosophie et d'histoire, au Collège d'Alès. Il était logé et nourri dans l'établissement et, pour 14 heures de classe, recevait un traitement de 1800 francs. Les états du personnel font de lui le plus grand éloge : « Intelligence peu ordinaire, dit l'un de ces états, enseignement remarquable par sa clarté, sa méthode, et ses facilités d'élocution » et un autre. « Il a les vertus du prêtre, du zèle, du dévouement, de la capacité et du savoir. Il fait ses classes consciencieusement et obtient des résultats généralement satisfaisants ». Mais, à coté de ces qualités, quelle exubérance de vie ne montrait pas l'abbé Cassan, lorsque, à ses heures libres, et comme pour se détendre de son enseignement, il se laissait aller à sa fantaisie ?
Ceux qui l'avaient approché se rappelèrent longtemps sa voix tonitruante, lorsque, après boire, indifféremment, il tenait, des propos légers, ou récitait du Lacordaire. Certains prétendaient même l'avoir vu, un jour, avec son ami l'abbé Bourély, se mettre â quatre pattes, la soutane retroussée, pour jouer au chat et â la souris !
Cet abbé Bourély était l'ancien aumônier du Collège depuis 1838, qui avait donné sa démission, en août 1853, pour fonder la paroisse de Rochebelle outre Gardon, disait-on à cette époque. L'abbé Cassan l'avait remplacé, en 1853, pour le carême de la chapelle du Collège. Ses prédications avaient obtenu un tel succès que le clergé paroissial, un peu jaloux, avait songé à demander â l'inspecteur d'Académie de faire interdire la chapelle au public. En 1857, c'est à Rochebelle même que l'abbé Cassan assura la station quadragésimale et eut la satisfaction de voir 700 hommes remplir leur devoir le jour de Pâques, dans la petite chapelle en planches qui tenait lieu d'église et céda, en 1863, la place à l'église actuelle. En I858, il fut désigné pour prononcer la distribution, des prix. Le journal local, « L'Aigle des Cévennes » nous a transmis le texte de ce discours où il développa cette idée : « La vie est une arène où tout homme est soldat et dont la palme est aux cieux.»
L’abbé Cassan quitta le Collège d'Alès, en 1863, pour celai d'Autun, puis de Mende, et mourut à Laissac, dans l’Aveyron, département dont il était originaire, le 18 mars 1881, à l’âge de 59 ans. Il avait donc à peine 36 ans, lors du séjour du « Petit Chose » au collège d’Alès.
Il passait, nous a dit Daudet, pour un original, et, dans le collège, tout le monde le craignait, même le principal, même Monsieur Viot. Disons également, à la suite du témoin dont nous ayons déjà parlé, Me Caumel, qui fut le servant de messe de l'abbé Cassan, que, cependant, tous, catholiques et protestants, s'accordaient pour l'aimer.
« Il était grand et fort longtemps je l'avais cru très beau mais un jour en le regardant de plus près, je m'aperçus que cette noble face de lion avait été horriblement défigurée par la petite vérole. Pas un coin du visage qui ne fût haché, couturé, sabré, un Mirabeau en soutane ....
« Je me sentais une grande sympathie pour cet étrange abbé. Son horrible et beau visage tout resplendissant d'intelligence m’attirait ; seulement on m'avait tellement effrayé par le récit de ses bizarreries et de ses brutalités que je n'osais pas aller vers lui. »
Daudet emprunta d'autres livres à l'abbé Cassan, et le revit plusieurs fois. « Jusqu'à la fin de l'année, cependant, dit-il, nous nous n’échangeâmes pas vingt paroles, mais qu’importe ! Quelque chose en moi même m'avertissait que nous étions de grands amis. »
Les ultimes évènements du séjour de Daudet à Alès n'allaient pas, en effet, tarder à le montrer.
En attendant, eut lieu la distribution des prix, avec toute la solennité que I'on apportait en ces temps-là à ces cérémonies. C'est le lundi 10 août que cet évènement prit place, sous la présidence du sous-préfet d'Alès, le Comte Saint Cir de Montlaur. Daudet nous en a donné une description pleine d'esprit et de couleur. « La chaleur était accablante et de grosses dames cramoisies sommeillaient à l'ombre de leurs marabouts, tandis que des messieurs chauves s'épongeaient la tête avec des foulards ponceau. Tout était rouge, les visages, les tapis, les drapeaux, les fauteuils. Rien d'étonnant à la chose, la cérémonie, nous apprend le journal local, avait commencé à une heure de l'après-midi ! Il y eut non pas trois, mais quatre discours prononcés. Le premier le fut par Monsieur Fajon, professeur de mathématiques supérieures sur La marche de l'esprit humain et les progrès de la science aux 17, 18 et 19me siècles. Vous. Papin et Wat, disait-il, dans ce style lyrique et pompeux, cher à nos grands pères, vous avez anéanti distances et limites. Portée sur les ailes de la vapeur, l'orgueilleuse locomotive se joue de l'espace. Puis il se hâtait de demander à ses auditeurs que le progrès scientifique ne refroidit jamais en eux l'amour sacré des belles-lettres. Le principal lui succéda et développa ce thème qu'il ne peut y avoir de vraie éducation si celle donnée par le maître n'est, pas soutenue par les parents. Le maire. Monsieur Duclaux Monteil, et le sous-préfet y allèrent à leur tour de leurs allocutions.
Puis, lorsque le dernier nom du dernier accessit de la dernière classe eut été proclamé et que la musique eut entamé une marche triomphale, tout se débanda et ce fut un tohu-bohu général.
C'est alors que ce produisit un incident douloureux que, nous a raconté Daudet, dans « l'Histoire de mes Livres ». Un de mes petits, a-t-il dit, nature fine, choisie, auquel je m'étais attaché, m'avait fait promettre de passer mes vacances chez lui à la campagne. Mais, le jour des prix, la famille me regarda à peine, et le pauvre petit s'en alla les yeux gros, tout honteux de sa déception et de la mienne. Minutes humiliantes qui fanent, déshonorent la vie. J'en tremblais de rage dans ma petite chambre, tandis que la voiture emportait l'enfant chargé de couronnes et les épais bourgeois qui m'avaient si lâchement blessé. On comprend la déception de Daudet, mais il était naïf de sa part de se leurrer d'espoir sur les propos inconsidérés d'un enfant, et de s'imaginer que la famille de celui-ci allait, ne le connaissant pas autrement, le recevoir et l'héberger pendant quelques semaines.
C'est en tout cas ce que l’ont fit au collège. Et ce « on » anonyme ne peut que désigner le principal.
A quoi s'occupa le jeune maître d'études pendant les cinquante jours où le collège fut fermé ?
A l'en croire, il aurait commencé à travailler avec acharnement, les philosophes grecs. Mais l'excès de travail joint à la chaleur torride furent cause d'une attaque qui le terrassa et, pendant plusieurs semaines, le tint à l'infirmerie. C'est alors qu'il aurait reçu la visite de son père. Pendant plusieurs jours, il aurait été soigné par une jeune orpheline des enfants trouvés qu'il avait déjà aperçue le soir même où il avait pénétré au Collège pour la première fois, et dont les yeux intensément noirs avaient fait une profonde impression sur lui. Mais ne voilà t’il pas que, lorsqu'il se fut décidé à lui remettre certains trois mots « les plus éloquents du monde », à ce qu'il parait, et qu'il n'avait pas osé lui dire, les yeux noirs ne revinrent pas. Les yeux noirs avaient été renvoyés aux Enfants trouvés où ils resteront enfermés pendant quatre ans jusqu'à leur majorité... car les yeux noirs volaient du sucre.
La jeune fille que Daudet a ainsi désignée a vraiment existé. Elle était la soeur d'une certaine demoiselle Rosa qui géra pendant longtemps le bureau de tabac situé star la place de la Mairie, près de la salle du Cinéma, le Trianon, et où l'abbé Cassan se faisait approvisionner en tabac par le jeune Caumel.
S’il est certain qu’Alphonse Daudet reçut un jour la visite de son père, les notes qui la signalent ne nous disent pas à quelle époque elle eut lieu. Ce fut peut-être, contrairement aux indications du roman, avant les vacances, car la mention de celles-ci ne vient que bien après l'indication de la venue en Alès de Monsieur Vincent Daudet.
De plus, pendant les vacances, Daudet fut-il vraiment malade, au point de ne pouvoir sortir pendant six semaines ?
Nous avons des doutes, tout au moins sur la longueur et la gravité de sa maladie, ne serait-ce que parce que les notes n'en ont pas parlé, elles se contentent de l'indication : les vacances, et aussi parce qu'il a bien fallu du temps à Daudet pour composer les poésies des « Amoureuses » qu'il avait en manuscrit dans sa malle, lorsqu'il partit pour Paris, au début de 1858, et qui ne tardèrent pas à paraître cette même année.
Comment alors employa t’il ses vacances ? Tout d'abord à écrire ces petits riens parfois mièvres et parfois délicats mais toujours finement ciselés que sont ses premiers vers imprimés et aussi qui pourrait en douter ? à fréquenter le café Barbette et la guinguette Espéron à la Prairie.
Enfin, eh quoi ! déjà la rentrée ? L'année scolaire recommença le 5 octobre, après une messe du Saint-Esprit si Joliment décrite par Daudet, et où les mots « Veni Creator Spiritus », répétés à quatre reprises amènent les différentes impressions visuelles et morales que cette messe produisit sur le petit maître d'études et leur donnent de l'unité.
Il fallut bien prendre à nouveau contact avec les élèves. Hélas ! Ils étaient demeurés mêmes et tout heureux de profiter du manque d'autorité de leur maître d'étude, ils lui menèrent la vie dure. Bientôt ce fut l’hiver. Trouvant sa mansarde trop froide, Daudet passait tout son temps libre au: café Barbette. Bien entendu, il n'était plus question de préparation au baccalauréat.
La situation était trop tendue pour pouvoir durer. En effet, au commencement de l’année suivante, 1858, Daudet quittait définitivement le Collège.
On sait comment à la suite de quels incidents où il joue un beau rôle, Daudet a raconté son départ. Le maître d'armes lui avait demandé de « trousser pour lui quelques poulets galants » afin de les envoyer, après les avoir recopiés, a une personne occupant Sarlande une situation élevée. Pendant un mois, Daudet écrivit en moyenne ses deux lettres de passion par jour à la blonde Cécilia. De ces lettres, les unes étaient tendres et vaporeuses, comme le Lamartine d'Elvire, les autres enflammées et rugissantes, comme le Mirabeau de Sophie.
Cécilia n'était qu'une femme de chambre ; comment donc pouvait-elle, selon les dires du maître d'armes, occulter une situation élevée ? Rappelons-nous que les domestiques sont d'ordinaire logés aux étages supérieurs, et nous comprendrons de quelle façon maître Roger avait pu mystifier le naïf « Petit Chose ».
Mais voilà, au lieu de recopier les lettres de sa belle écriture de sous-officier, le maître d'armes les envoyait telles qu'elles, et un beau jour, elles furent découvertes par la sous-préfète qui avait à son service la fameuse Cécilia. L'auteur des lettres fut vite identifié ; le sous-préfet se rendit au collège et le « Petit Chose » fut appelé en sa présence ; mais ne voulant pas dénoncer Roger, il ne dit pas le mot qui pouvait le disculper.
A quoi pouvait-il s'attendre, sinon à être renvoyé du Collège ? Que faisait pendant ce temps le maître d'armes apprenant l'attitude de Daudet ? Il lui avait promis de se dénoncer et lui avait déclaré son intention de se suicider ensuite pour ne pas survivre à son déshonneur.
Sur les instances de Daudet cependant, il avait consenti à surseoir à sa décision. Comédie que tout cela le « Petit Chose » ne tarda pas à l'apprendre en entendant à la guinguette Espéron, sans que l'on soupçonnât sa présence, le maître d'armes rire grossièrement, au cours d'une partie fine, du bon tour qu'il avait joué au trop crédule jeune maître d'études. La rage au coeur, Daudet retourne à Alès et, soudain, la pensée lui vint de se donner la mort. Il allait mettre son projet à exécution en se pendant à l'anneau de la salle de gymnastique du Collège, lorsque l'abbé Germane passant là par hasard le saisit, et malgré sa résistance, l'emporta sous son bras comme un paquet dans sa chambre.
Il était sauvé, non seulement parce que l'abbé Germane l'avait empêché de se suicider, mais encore parce qu'il lui donna l'argent nécessaire pour payer ses dettes au concierge et au café Barbette et pour pouvoir prendre le train pour Paris, ce Paris d'où son frère Ernest l'avait appelé à le rejoindre. Le départ d'Alphonse aurait eu lieu le 28 février 1858. Il serait allé directement à Nîmes, aurait embrassé sa mère et puis, après un long voyage de deux jours serait enfin arrivé dans la capitale où « Mère Jacques », c'est-à-dire Ernest, l'attendait.
On nous permettra d'être sceptique sur la plupart des conditions dans lesquelles Daudet aurait quitté le Collège d'Alès.
Lorsqu'on se réfère aux notes du tout premier projet du « Petit Chose », on y lit ces brèves indications : « Je fais connaissance avec Mademoiselle Lucile. Je lui fais des vers. L'intrigue ; victime du maître d'armes ». C'est tout, mais n'est-ce pas assez et d'un ton suffisamment sincère pour démolir le long et, ma foi, touchant échafaudage édifié par Alphonse Daudet ?
Ce n'est sûrement pas pour le compte du maître d'armes que le « Petit Chose » écrivait ses lettres en prose ou en vers, mais, pour son propre compte; non pour une « Cécilia » qui cependant a pu exister, il y avait bien peu de distance entre le Collège et la sous-préfecture, alors située dans la rue Albert 1er, mais une autre jeune fille, Lucile. Qui était-elle ? Un peu plus haut dans ses notes, Daudet l'appelle Lucile Espéron. Elle faisait vraisemblablement partie de la famille qui à la Prairie, tenait la guinguette portant ce nom d'Espéron. Il est loisible de conjecturer que le jeune Daudet ayant confié au maître d'armes ses aventures sentimentales qui, peut-être, avaient dépassé les limites permises, celui-ci porta toutes chaudes au principal les confidences qui lui avaient été faites, et le principal fut contraint de se débarrasser d'un collaborateur qui nuisait au bon renom de son établissement.
S'il était nécessaire; nous serions affermi dans notre opinion par l'affirmation d'un vieil Alésien, aujourd'hui disparu, félibre majoral et ami de Mistral, Mistral dont on connaît les liens puissants qui l'unissaient à Alphonse Daudet. Cet Alésien, Monsieur Alcide Blavet, ancien avoué, a écrit dans les « Mémoires de la Société Scientifique et Littéraire d'Alais » en 1913, les lignes suivantes qui en disent long : « Daudet s'égayait avec toutes les ardeurs de sa fougue juvénile. Le bon chef paternel, c'est le principal, cacha longtemps les peccadilles du petit maître d'études, mais celui-ci ayant fait scandale, parait-il, dut retourner à Nîmes. Daudet partit, continue Monsieur Blavet, ou du moins simula un départ, car, à peine arrivé avec la diligence au premier relais à l'Habitarelle, il tourna bride en rentra à la hâte dans cette abominable ville de Sarlande contre laquelle il a tant vitupéré. Grand émoi de sa famille qui l'attendit en vain à l'arrivée de là voiture dans la cité romaine. On le chercha partout en Alès et ce n'est qu'au bout de quelques jours qu'on le trouva...
Ici j’arrête ma citation, et je me contente de résumer ce qui suit par ces simples mots, on le trouva en... trop bonne compagnie. Est-il besoin d'ajouter que cette histoire de faux départ pour Nîmes du « Petit Chose » ne se trouve pas dans le roman ? Elle est remplacée par un court chapitre où Daudet prête à son oncle Raynaud, un digne homme pourtant, un rôle ridicule et sûrement faux.
Si l'essentiel des événements qui ont motivé le renvoi d'Alphonse Daudet du Collège d'Alès a été ainsi dénaturé, que penser des épisodes secondaires qui auraient accompagné ce renvoi ?
Celui de la tentative de suicide a été déclaré exact par le principal du collège dans une interview que, sur la fin de sa vie il a donné à Gabriel Haon et qui a été publié dans le Journal d’Alais, du 26 décembre 1897. Il se peut d’autre part que l'abbé Cassan ait prêté quelque argent au « Petit .Chose ». Un écrivain. Monsieur d'Alméras, a bien affirmé que Daudet aurait économisé cent francs, soit à sou, pour passer son baccalauréat, mais qu'il préféra les employer à payer son voyage à Paris. Tout ce que nous savons sur l'absence d'ordre et d'économie de Daudet, qui ne fut qu'un grand enfant jusqu'au jour où son mariage avec une femme positive, et pratique le fixa enfin, tout cela nous incite à croire qu'il n’avait rien à lui lorsqu'il dut quitter Alès...
Reste la date de ce départ. Le 28 février, prétend le roman. Or, ce jour-là, ni les jours précédents, ni les jours suivants, il ne neigea à Alès, contrairement à ce qu'affirme le « Petit Chose ». Si, du 22 au 23 février, nous apprend le journal local, il tomba de la neige en abondance dans les Cévennes, neige qui blanchissait la crête des montagnes situées au nord d'Alès, il n'y eut dans la ville, le 25 février, qu'une chute de grêle.
Devons-nous en conclure que la date du 28 février est inexacte ? Pas nécessairement. Il n'en reste pas moins que, pour enjoliver son récit et rendre son départ plus tragique, et peut-être chercher à faire croire plus ou moins consciemment que son coeur était aussi blanc que la neige qui tombait, Daudet a imaginé des conditions climatiques qui n'ont pas existé en réalité.
Lorsqu'on a terminé la lecture du « Petit Chose », on a l'impression que Daudet a été on ne peut plus malheureux à Alès et que le collège, ainsi qu'il l'a dit dans un autre de ses livres, fut, pour lui, une geôle affreuse.
Telle n'a pas été l'opinion de deux hommes qualifiés pour dire leur mot sur cette question.
Le « Petit Chose », a affirmé Monsieur Blavet, est une légende touchante, mais une oeuvre injuste, car le petit pion nîmois mena au collège d'Alès des jours heureux et calmes, pris en affection par son principal, protégé et réconforté par sa bienveillance et son accueil, s'asseyant plus souvent à la table de cet ami débonnaire qu'à la table commune du sobre réfectoire.
Frédéric Mistral n'est, pas moins catégorique. Selon lui, Daudet reçut, un bon accueil à Alès, y passa du bon temps et aimait se rappeler cette ville. (Nous pouvons nous-mêmes ajouter qu'il y revint plusieurs fois, en particulier, en août 1892, où nous apprennent les Tablettes d'Alais, il assista à une course de taureaux). Sans doute, par cette sensibilité extrême qui le caractérisait, il dut souffrir un .moment de l'exil du foyer paternel, et d'être obligé, en ses seize ans, de gagner sa vie, mais les idées noires, il ne les eut jamais ; il fut au contraire, parfaitement heureux, tout le reste est littérature.
Parfaitement heureux, nous ne croyons pas qu'il faille aller jusque là, Daudet A sûrement souffert à Alès de la part de ses élèves qu'il n'avait pas su dominer. Son principal, Monsieur Roux, a rappelé plus tard son air habituellement triste, et son état de perpétuel rêveur. Mais Daudet, lorsqu’il écrit son roman, a été porté à exagérer ses infortunes, vielles de dix ans. Lancé alors sur la voie des succès, il a été humilié d'avoir été dénué de ressources, réduit à emprunter argent et vêtement, et contraint d'exercer une profession effacée et alors inférieure. Un autre aurait peut-être, gardé le silence, mais Daudet qui, au cours de son existence, n'a pas eu honte de nous raconter plus d'une circonstance peu honorable de sa vie, n'a pu s'empêcher de parler. Il a voulu qu'on le plaignit et, pour exciter la pitié de son lecteur, il a poussé au noir le tableau de son séjour à Alès, cherchant à se donner le beau rôle, avouant bien certaines peccadilles, mais dissimulant habilement ses écarts graves de conduite.
Mais alors, dira-t-on, le « Petit Chose » renferme des mensonges ?
Assurément oui, et Daudet lui-même les a reconnus, non pas explicitement pour ce livre, mais pour l'ensemble de son ouvre.
Dans un de ses livres : « Premier voyage, premier mensonge. » parlant des histoires mensongères qu'il n'avait cessé de raconter aux passagers du « Bonnardelle », le bateau sur lequel il avait fait le voyage de Beaucaire à Lyon, lorsque ses parents quittèrent Nîmes, il déclares : « Mon mensonge n'avait rien de pervers ni d'utilitaire ; j'étais surtout menteur par imagination ; j'avais fini par me tromper moi-même. »
Et plus loin, il n'hésite pas à avouer : « .J'ai continué ce que je commençais sur le Bonnardelle : à inventer des histoires pour faire rire ou émouvoir un cercle de braves gens ». (Page 199)
Avec un fond de vérité certes, le « Petit Chose » n'est-il; pas une de ces histoires ? Nous en avons suffisamment donné des preuves plus haut pour pouvoir en douter.
En réalité, même si nous laissons de côté ses aventures sentimentales, Daudet a connu à Alès la sympathie de Monsieur Roux et de l'abbé Cassan. Il y a également fait la connaissance de Jean Baptiste Dumas, dont l'appui, nous appris Monsieur Roux, plus tard ne lui fit pas défaut. Peut-on dire que, dans ces conditions, Daudet n'ait eu que des motifs de se plaindre pendant la très courte année où il demeura à Alès ?
A ces différents titres, le « Petit Chose » est une belle oeuvre qui durera, que l'on lira toujours avec plaisir et émotion parce qu'elle est personnelle et débordante de vie. Comme telle, elle ne cessera de réjouir les esprits et de faire battre les coeurs.
Extrait des Mémoires de l’Académie de Nîmes, Tome LII, 1945, page 119 à 148. Texte du Chanoine Marcel Bruyère, docteur ès lettres, aumônier du Lycée d'Alès.
Images copies de l’édition de 1877, HISTOIRE D’UN ENFANT de J. Hetzel et Ci, 18, rue Jacob - Paris Dessins de P. Philippoteaux & gravures de Laplante
EN SAVOIR PLUS SUR LA VIE DE DAUDET > En avril 1857 arrivée du petit chose à Sarlande. Alphonse Daudet âgé de 17 ans à Alès> La version édulcorée du Petit Chose > Le Nabab - La véritable histoire de son modèle, l'exentrique François Bravay > Alphonse Daudet antisémite ? > Alphonse Daudet adulte, était-il encore un nîmois de coeur ? > La maladie cachée de Daudet, La Doulou (La douleur) > Polémique sur l'inauguration statue de Daudet à Nîmes > Article Midi Libre du 26 juin 2005
. |